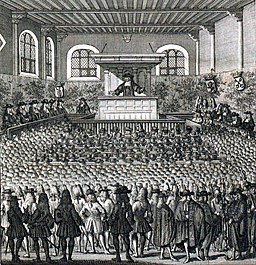
Cognition & Education
Explorer les articles
-
Les textes du carnet Cognition–Éducation sont désormais publiés sur Substack Read more ⇢
-
Les étudiants disent ne pas avoir la tête aux études… qu’en dit la science ?
Peur, anxiété, inquiétude, manque de motivation et difficultés de concentration… Les étudiants évoquent toutes sortes de raisons pour s’opposer à l’enseignement à distance. Excuses ou réel désarroi ? Voici ce qu’en… Read more ⇢
-
Étudier et enseigner à distance : trois leçons apprises utiles au temps de la crise
Alors que le Québec se retrouve en mode « pause », les universités implantent, dans l’urgence, divers scénarios d’enseignement à distance ou plutôt, en « non présentiel »[1]. Pourtant, une… Read more ⇢

